Écrire un roman, c’est comme s’embarquer sur un radeau pour traverser l’Atlantique avec une rame, deux barres de céréales, et ton chat qui te regarde comme si tu étais la plus grosse erreur de sa vie. Mais soyons honnêtes : si tu bloques, ce n’est pas parce que tu manques d’idées. C’est parce que tu ne sais pas OÙ tu vas.
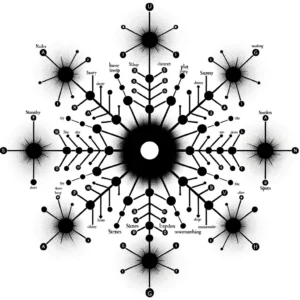
Et là, je ne te parle pas d’avoir tout ton plan en Excel (détends-toi, ça va bien se passer), mais de trouver une structure qui TE convienne, à TOI, avec ton cerveau, ton rythme, ton style, tes personnages possédés qui refusent de faire ce que tu veux.
Alors voici un petit tour d’horizon de structures que tu peux tester, tordre, balancer, embrasser. Bref, fais ton marché.
Le voyage du héros (alias « Frodo a des emmerdes »)
Structure mythique, vieille comme le monde mais toujours efficace. Tu pars avec un personnage ordinaire, un événement vient tout bouleverser, et c’est le début d’une grande aventure. Il va traverser des épreuves, rencontrer des alliés et des ennemis, mourir symboliquement, renaître transformé, et revenir à son point de départ… changé.
C’est puissant parce que c’est archétypal. On connaît tous ça intérieurement. Un héros qui refuse l’appel, qui hésite, puis se jette dans le vide.
Ça donne quoi ? Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Eragon, Billy Summers de Stephen King…
Pour qui ? Pour les conteurs classiques, les fans de quêtes, ceux qui aiment voir leur perso évoluer sous pression.
À éviter si tu veux juste écrire un roman intérieur sans tension forte ou transformation radicale.
La structure en mosaïque (alias « j’écris comme je pense »)
C’est l’anti-linéaire. Tu racontes ton histoire par fragments : des bouts de vie, des voix différentes, des temps qui se croisent. Pas d’ordre strict, mais un fil rouge thématique.
Tu donnes au lecteur des pièces de puzzle. Il les assemble. Ça demande un peu plus d’attention, mais ça crée souvent des émotions très fines.
Exemples ? Ensemble c’est tout (Anna Gavalda), Olive Kitteridge (Elizabeth Strout), Les choses humaines (Karine Tuil).
Pour qui ? Pour les sensibles, les monteurs, les faiseurs de patchworks littéraires.
Attention : exige rigueur thématique. Sinon, on perd ton fil et on décroche.
La structure flocon de neige (alias « j’ai besoin que tout soit sous contrôle »)
Méthode hyper structurée : tu pars d’une phrase, tu développes en un paragraphe, puis en un plan de chapitres, puis tu détailles chaque chapitre. C’est parfait pour ceux qui ont besoin de tout voir avant d’écrire.
Inventée par Randy Ingermanson, cette méthode rassure. Tu ne te lances jamais sans avoir ton matos sous les yeux.
Ça marche bien pour les gens anxieux du chaos narratif.
Pour qui ? Les perfectionnistes, les architectes, ceux qui veulent tout cadrer.
Limite : tu risques de figer ton récit si tu ne laisses pas de place à la surprise.
La structure circulaire (alias « tout change, mais rien ne change »)
Tu ouvres ton roman à un point A, tu explores, et tu refermes à ce même point A. Mais ton personnage, lui, est transformé.
Tu montres un cycle. Un retour. C’est introspectif, poétique. Ça fonctionne super bien pour des récits où la fin fait écho au début, comme une leçon que le personnage ne pouvait comprendre qu’en passant par tout ça.
Exemples ? L’Étranger, Forrest Gump, Into the Wild, certains récits de Zweig ou de Modiano.
Pour qui ? Ceux qui aiment les boucles, les symboles, les histoires qui tournent doucement sur elles-mêmes.
La structure en spirale (alias « j’écris autour d’un traumatisme »)
C’est un modèle qui revient, qui tourne, mais à chaque tour on creuse. Le personnage tourne autour de son problème central, de plus en plus près, jusqu’au cœur.
C’est parfait pour des récits psychologiques, ou les romans à tension sourde.
Exemples ? Shutter Island, Before I Go to Sleep, certaines nouvelles de Stephen King.
Pour qui ? Ceux qui veulent écrire sur des obsessions, des secrets enfouis, des passés qui ne passent pas.
Pas de structure du tout (alias « j’écris au feeling »)
Tu écris. Point. Tu découvres ton histoire en même temps que ton personnage. Pas de plan, pas de filets. C’est la méthode des écrivains organiques.
Stephen King en parle beaucoup : lui, il jette un personnage dans une situation et voit ce qu’il se passe. Résultat : des récits bruts, vivants, imparfaits mais vibrants.
Pour qui ? Les instinctifs, les sauvages, ceux qui veulent que ça pulse avant que ça tienne debout.
Limite : c’est souvent très exigeant en réécriture. Mais très jouissif à vivre.
Et toi, tu choisis quoi ?
Tu peux tester, mixer, inventer ta propre recette. Ce n’est pas la structure qui fait ton roman. C’est ton feu. Ta voix. Ton envie de dire un truc que t’as pas encore dit.
Mais une bonne structure, c’est un bon squelette. Ça te tient. Ça t’empêche de t’effondrer page 37.
Alors choisis celle qui t’aide à écrire. Même si ce n’est pas celle qu’on t’a apprise. Même si ce n’est pas celle des autres. Choisis celle qui te donne envie de continuer. Celle qui, quand tu l’as trouvée, te donne juste envie de dire : « Bon. Là, j’y vais. »
Et si tu veux creuser tout ça, j’ai écrit un guide entier sur le sujet. Sérieux, fouillé, mais pas chiant. Promis.
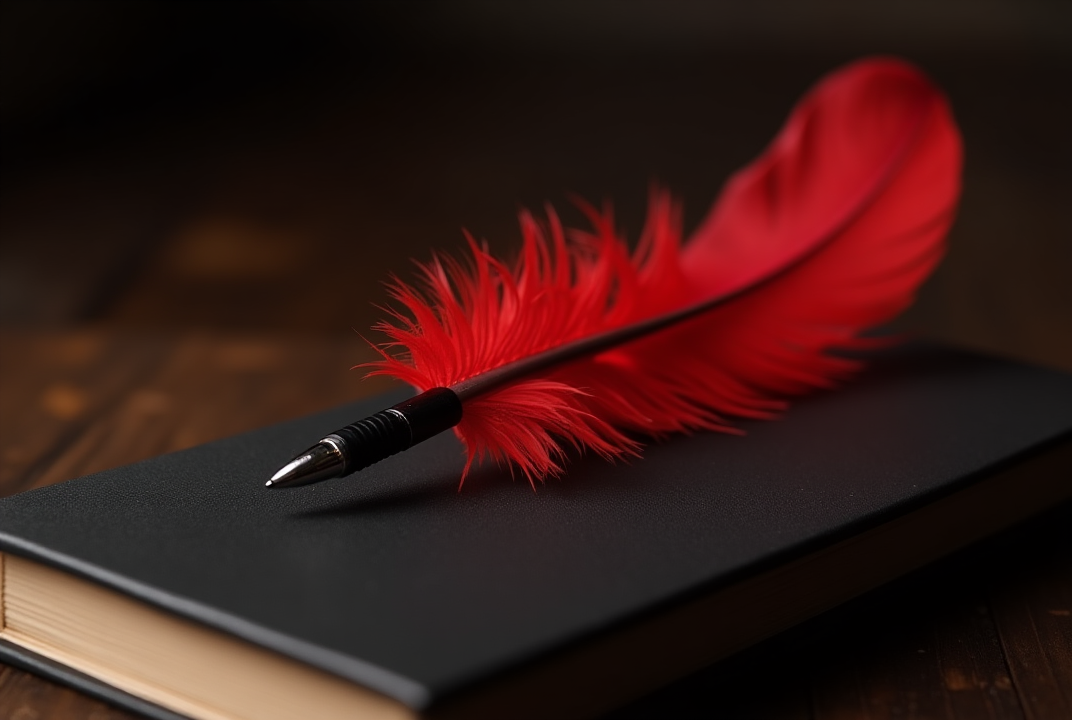

Coucou Marina,
Très inspirant toutes tes propositions…
J’hésite entre mosaïque et flocons de neige..?je finis formation et verrai au feeling.
Merci
Merci à toi Marie et Christine 😉 Les flocons de neige, c’est une belle métaphore pour expliquer qu’au plus tu roules une boule de neige dans la neige, au plus elle grossit, c’est une belle manière de progresser, comme si tu avançais avec un filet. Mosaïque, ce sont des pièces que tu vas emboîter les unes dans les autres. Diana Gabaldon, l’auteur de « Outlander », écrit des morceaux d’histoire, souvent sans savoir où elle va les placer au départ, elle était mathématicienne à la base. Belle journée à toi.